Une contrefaçon qui dure…
Publié le 14 août 2012

Bonjour
L’article d’aujourd’hui sera consacré à l’analyse d’un jugement rendu en janvier 2010 en matière de contrefaçon, et qui contient plusieurs enseignements.
Les faits
Une photographe qui avait effectué des prises de vue pendant le tournage du film “Lettres d’amour en Somalie”, de F. Mitterand, avait ensuite vu ses photographies publiées par l’éditeur du livre du même nom dans l’ouvrage qui contenait le texte de l’auteur. Cet ouvrage avait été publié en 1983 et réédité en 1986 et 1991. L’édition et la diffusion de l’ouvrage avaient cessé en 2001.
La photographe reprochait à l’éditeur de ne pas disposer des droits de reproduction sur ces photographies, et de ne jamais lui avoir adressé de décompte (depuis 1983) des exemplaires vendus, pas plus que de ses droits d’auteur sur la reproduction des photographies
Elle faisait également valoir :
– que son nom comportait une faute d’orthographe dans la première édition du livre
– et que le livre lui-même avait ensuite été édité au format poche sans son autorisation, les photos étant alors réduites, mal scannées, et imprimées dans une qualité médiocre, la série ayant été de surcroît amputée puisque seules 18 photos sur les 33 avaient été retenues dans l’édition poche.
Elle avait pu négocier avec l’éditeur de la version poche du livre un accord transactionnel, mais restait à solliciter une indemnisation de la part de l’éditeur d’origine. Ce dernier lui avait adressé en 2007 – après vraisemblablement mise en demeure bien que cela ne soit pas précisé – une chèque d’environ 3000 € représentant, selon l’éditeur, le solde des droits lui revenant et auquel était joint un décompte d’une partie des ventes (pour la période de 1990 à 2001). Mais aucun accord global n’était intervenu, de telle sorte qu’elle avait finalement assigné l’éditeur et l’auteur devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Pour ce dernier, l’assignation était sans doute motivée par le désir de ne pas se voir reprocher de n’avoir pas attrait tout le monde à la cause, mais le jugement rendu est essentiellement une passe d’arme entre la photographes et l’éditeur, qui semblait prendre seul les décisions quant à l’illustration de l’ouvrage.
Le jugement (TGI Paris, 3ème ch., 4ème section, 28/1/2010, RG09/06621)
Dans son assignation, la photographe sollicitait la condamnation des défendeurs :
– au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de ses droits d’auteur (volets patrimoniaux et moraux réunis)
– et d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
L’éditeur soulevait face à ces demandes les défenses suivantes :
– l’action était selon lui prescrite, la première édition de l’ouvrage étant ancienne
– le défaut d’originalité des photographies publiées, s’agissant de photographies de plateau prises sur le tournage du film. Selon lui, en effet, “les sujets, les angles de prises de vue et les cadrages sont identiques à ceux retenus par le réalisateur du film et (elles) ne portent pas l’empreinte de sa personnalité”.
– une avance de droits d’auteur avait été envoyée en 2004, ce qui démontrait bien l’existence d’un contrat (la photographe contestait avoir reçu quoi que ce soit, et l’éditeur restait cependant en défaut de démontrer que le chèque prétendument envoyé avait été encaissé)
– quant à l’édition poche, et puisqu’il lui était reproché d’avoir cédé les visuels à l’éditeur du petit format, il relevait qu’il n’avait cédé de droits que sur le manuscrit et que par ailleurs la photographe avait déjà transigé avec l’éditeur de la version poche, ce qui privait de fondement toute demande à son encontre
– et, enfin, que l’ouvrage publié à l’origine (les versions de 1983, 1986 et 1991) était en réalité une œuvre composite sur laquelle il détenait les droits d’exploitation
Face à ces argumentations, le TGI a considéré :
– Quant à la prescription :
“Que l’action en contrefaçon se prescrit par 10 ans en application de l’article 2270-1 ancien du Code civil, et le point de départ de la prescription s’entend du dernier acte de diffusion de l’ouvrage puisque la contrefaçon est un délit continu et que l’infraction débute avec la publication et se poursuit tout le temps de la mise à disposition du public de l’œuvre.”
En l’espèce, puisque l’ouvrage avait été soldé en 2001, et l’action introduite par assignation du 18 janvier 2008, la prescription n’était pas encore acquise à cette date
NOTE : Ceux d’entre vous qui suivent régulièrement le blog se souviendront peut-être d’un article que je publiais en novembre 2010, et où j’évoquais une prescription de 5 ans pour ce type d’action civile. Ceci n’est pas en contradiction avec le jugement que nous évoquons aujourd’hui puisque comme l’indique le jugement lui-même, c’est l’article 2270-1 ANCIEN du Code civil qui doit être appliqué. L’assignation date en effet de janvier 2008, avant la modification des délais de prescription en matière civile. A l’heure d’aujourd’hui, le raisonnement serait donc identique, mais sur une base quinquennale et non décennale.
– Sur l’originalité des photographies
Le TGI rappelle que des photographies de plateau peuvent être originales (et donc protégeables) pour autant qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Ceci est conforme avec l’enseignement de la jurisprudence que je commentais en mai 2011 dans CET ARTICLE quant à l’originalité des photographies de plateau.
Dans le cas présent, le TGI souligne en outre la mauvaise foi de l’éditeur qui avait envoyé un chèque en 2007 (peu avant l’assignation, et sans doute après mise en demeure, alors que les parties recherchaient en vain un accord amiable) :
“Ainsi, la défenderesse a reconnu sans ambiguïté à (la photographe) la qualité d’auteur, les photographies dont s’agit sont dignes de protection au titre du droit d’auteur.
Dans ces conditions, la défenderesse ne saurait sans mauvaise foi remettre en cause l’originalité des clichés litigieux au seul motif que ce sont des photographies de plateau qui ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, étant rappelé que des photographies de plateau peuvent être originales si elles témoignent d’un effort créatif, ce qui est le cas en l’espèce.”
– Sur le défaut de contrat
Le TGI relève ensuite qu’aucun contrat n’a été signé et que l’éventuel envoi d’un chèque en 1984 (que la photographe contestait avoir reçu et dont l’éditeur ne pouvait pas démontrer qu’il avait été encaissé) ne suffisait pas à attester de l’existence d’un accord entre les parties quant à la publication des photographies.
Dès lors, et à défaut d’accord de la photographe pour les éditions de 1986 à 1991, et à fortiori pour l’édition poche de mars 2000, il fallait admettre la contrefaçon, l’éditeur n’ayant en outre pas adressé le moindre décompte pendant 23 ans, ni tenu la Photographe informée de la mise en solde de l’ouvrage en mai 2001, “ce qui donne à penser que les conditions d’exploitation des photographies litigieuses n’ont jamais été déterminées d’un commun accord entre les parties, dans le respect des dispositions de l’article L1131-3 du Code de la Propriété intellectuelle”.
La contrefaçon est donc établie.
Quant à l’édition poche, le Tribunal fait également droit aux demandes de la photographe, en considérant “qu’il est acquis que, sous couleur d’une exploitation séparée de la contribution personnelle (de l’auteur), l’éditeur a exploité en réalité l’œuvre de collaboration que constitue “Lettres d’amour en Somalie” et permis matériellement aux Editions Pocket de reproduire en noir et blanc, petit format et dans une qualité très médiocre, après les avoir scannées, certaines photographies (de la demanderesse).
Dans ces conditions, elle a porté atteinte au respect et à la destination de l’œuvre de la demanderesse, et s’est rendue également coupable de contrefaçon par violation du droit moral de l’auteur qui n’a pas donné son accord à une telle exploitation de ses photographies.”
La seule demande qui n’est pas couronnée de succès est celle relative à la faute d’orthographe dans le nom de la photographe, puisque cette faute avait été corrigée dès la seconde édition du livre en 1986.
Au titre du préjudice
Enfin, pour indemniser la demanderesse, le TGI lui accorde une somme de 10.000 €. Bien entendu, l’éditeur qui sollicitait 1 € symbolique au titre d’une action prétendument abusive est débouté, et est condamné au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire du jugement étant en outre accordée (il est donc exécutable nonobstant un éventuel appel.
Je n’ai pas connaissance qu’un appel ait été interjeté, mais comme toujours, cela ne signifie pas que ce ne soit pas le cas. Nous ne le découvrons généralement (sauf à être impliqué dans l’instance) qu’au moment où l’arrêt éventuel est publié.
Que retenir de ce jugement ?
Au titre des confirmations toujours utiles :
– que la contrefaçon est un délit continu, qui ne s’arrête qu’au moment du dernier acte de diffusion (ici 2001, mise en solde de l’ouvrage dans son format originaire), de telle sorte que la prescription ne se compte qu’à compter de ce moment
– et que les photographies de plateau sont susceptibles de protection au titre du droit d’auteur si elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur
Au-delà de ces confirmations, le jugement est très clair sur la reproduction en noir et blanc et en qualité médiocre des photographies : il s’agit bien d’une atteinte au droit moral de l’auteur, en l’occurrence son droit “au respect et à la destination de l’œuvre” (le CPI parle de “droit à l’intégrité de l’œuvre”, ce qui revient au même).
Et sur ces considérations, je vous souhaite une excellente journée
Joëlle Verbrugge

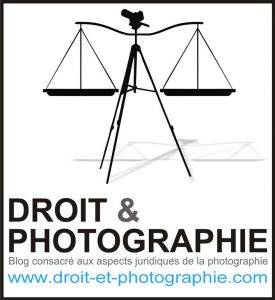
Bravo Joëlle pour votre travail qui rend intelligible et accessibles les textes de loi et permet de suivre la jurisprudence en ce domaine.
Bien cordialement,
Nadine, iconographe freelance